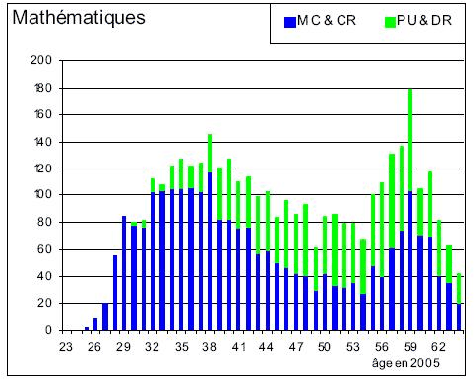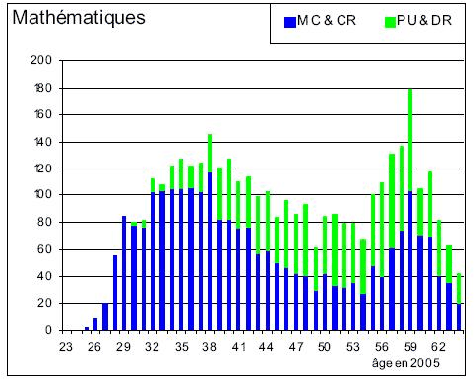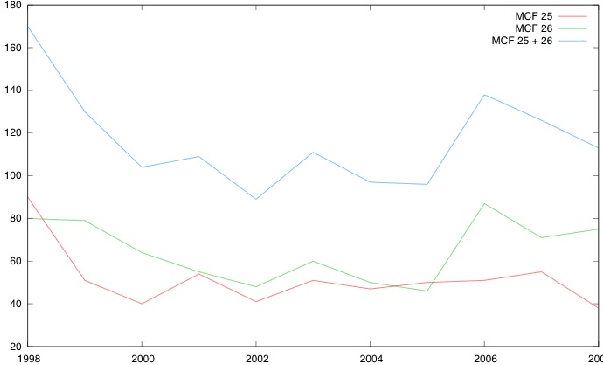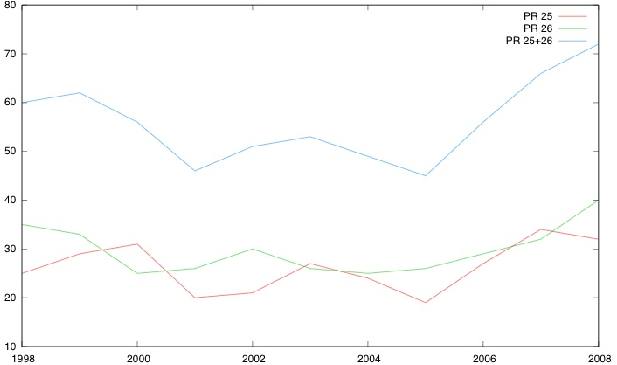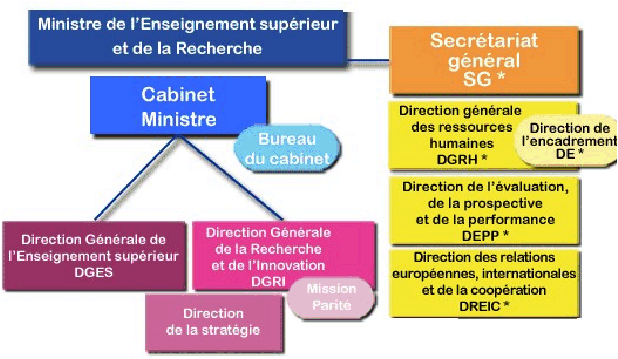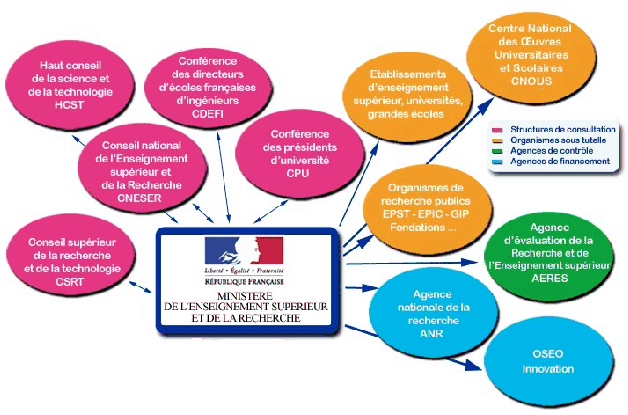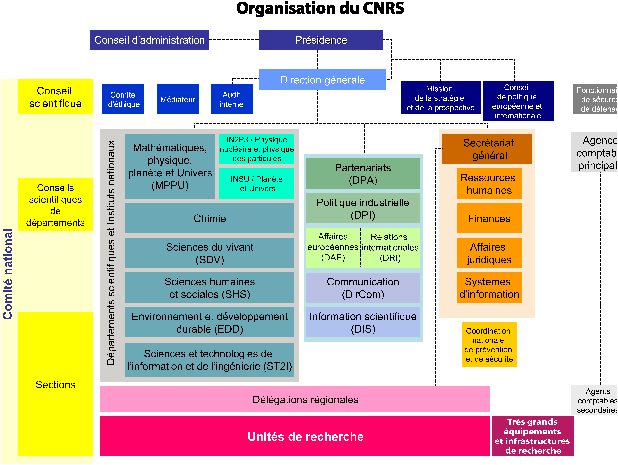-
Action de recherche collaborative (ARC), 14.2.3
- Affectation des chercheurs CNRS, 2.4
- Agence d'évaluation
de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES), 10
- Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES), 1.5
- Agence nationale de la recherche (ANR), 14.1
- ANTARES, 11.2.1
- Animath, 16.2
- ArXiv, 7.4.3
- Assistant, 11.2.4
- Association française d'informatique
fondamentale (AFIF), 16.7
- Association nationale des docteurs ès sciences
(ANDèS), 16.4
- Association pour la statistique et ses utilisations (ASU), 15.3
- Bonus qualité recherche (BQR), III, 13.1.5
- Bureau de recherches géologiques et minières
(BRGM), 5.2
- Cellule de coordination documentaire nationale
pour les
mathématiques (MathDoc), 7.4.3
- Centre de
recherche INRIA (CRI), 3.1.2
- Centre de calcul, recherche et technologie (CCRT), 7.4.3
- Centre informatique national de l'enseignement
supérieur (CINES), 7.4.3
- Centre international de mathématiques pures et appliquées (CIMPA), 16.3
- Centre international de rencontres mathématiques
(CIRM), 15.1
- Centre international de rencontres mathématiques (CIRM), 7.4.3
- Centre national de recherche scientifique (CNRS), 7
- Centre pour la communication scientifique directe (CCSd), 7.4.3
- Chargé de recherche (CR)
- Comité national de la recherche scientifique
(CN), 2.4, 12
- Commissariat à l'énergie atomique (CEA), 5.2
- Commission de spécialistes (CSE), 1.9.2
- Commission des colloques et congrès internationaux (CCCI), 14.5.1
- Compte rendu annuel d'activité des chercheurs du CNRS (CRAC), 12.2.2
- Confédération des étudiants chercheurs
(CEC), 16.6
- Confédération des jeunes chercheurs (CJC), 16.6
- Congé pour recherche ou conversion thématique
(CRCT), 1.10.1, 11, 11.2.3, 13.1.5
- Congé pour recherche ou conversion thématique (CRCT), 1.5
- Conseil
scientifique (CS), 13.1.5
- Conseil d'administration (CA), 1.1, 1.5, 1.9.2, 6.2
- Conseil des études et de la vie
universitaire
(CEVU), 6.4
- Conseil des études et de la vie universitaire
(CEVU), 1.1
- Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche (CNESER), 1.9.2
- Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), 5.6
- Conseil national de la recherche scientifique
(CNRS), 5.2
- Conseil national des universités (CNU), 1.7.1, 1.10.1, 11
- Conseil scientifique
(CS), 1.1
- Conseil scientifique (CS), 1.10.1, 6.3
- Contrats de plan État-Régions (CPER), 5.2
- Cumul d'activité
- Délégation, 1.10.2
- Délégation régionale à la recherche et à la technologie (DRRT), 5.2
- Détachement, 1.10.3
- Directeur de recherche (DR), 1.2
- Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), 5.4
- Direction des relations européennes, internationales et de la coopération (DREIC), 5.1, 5.2, 5.3, 14.3.1
- Direction générale de l'enseignement supérieur
(DGES), 5.1, 13.1.3
- Direction générale de la recherche et de l'innovation (DGRI), 5.2, 14.3.1
- Direction générale des ressources humaines
(DGRH), 5.5
- Echange de postes (transfert croisé), 1.9.2
- Enseignant-chercheur (EC), 1.1
- Equipe d'accueil (EA), 13.1.4
- Equipes-projets INRIA (EPI), 8.3
- ERC Starting Grant, 14.2.1
- Etablissement d'enseignement supérieur et de recherche, 6
- Etablissement public à caractère administratif
(EPA), 14.1
- Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), 5.2
- Etablissement public à caractère scientifique
et technologique (EPST), 5.2, 7
- European Mathematical Society (EMS), 15.3
- Evaluation
- Evaluation-orientation de la coopération scientifique
(ECOS), 14.4.1
- Fondation de Coopération scientifique (FCS), 9.2
- Formation de recherche en évolution (FRE), 1.10.2
- Grand équipement national de calcul intensif
(Genci), 7.4.3
- Groupement d'intérêt public (GIP), 14.1
- Groupement de recherche (GDR), 12.2.3
- Groupement de services (GDS), 7.4.3, 12.2.3
- Guilde des doctorants (GDD), 1.8.1, 16.5
- Habilitation à diriger des recherches (HDR), 1.5, 2.3.1, 3.4, 11.2.1
|
- Haut conseil de la science et de la technologie (HCST), 5.2
- Institut de recherche
pour le développement (IRD), 5.2
- Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement (Cemagref), 5.2
- Institut du développement et des ressources en informatique
scientifique (IDRIS), 7.4.3
- Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer), 5.2
- Institut français du pétrole (IFP), 5.2
- Institut Henri Poincaré (IHP), 7.3, 7.4.3
- Institut International de Statistique (IIS), 15.3
- Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), 5.2
- Institut national de recherche agronomique (Inra), 5.2
- Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA), 3, 5.2, 8, 13.2.2, 14.2.3, 14.4.3
- Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (Inrets), 5.2
- Institut universitaire de technologie (IUT), 6
- Institut universitaire professionnalisé (IUP), 6
- Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM), 1.4
- Journal Officiel (JO), 1.1
- Labintel, 2
- Licence, Master, doctorat (LMD), 5.1, 5.6
- Loi organique relative
aux lois de finances (LOLF), 5.2, 13.1.3
- Loi relative aux libertés et
responsabilités des universités (LRU), 1.1
- Loi relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU), ??
- Maître de
conférences (MCF), 11.1
- Maître de conférences (MCF), 1.1
- Mathrice, 7.4.3, 7.4.3
- Ministère de (l'enseignement supérieur et de) la recherche (MR), 5, 14.3.1, 14.5
- Ministère des affaires étrangères (MAE), 14.3.1, 14.5
- Mission interministérielle de recherche et d'enseignement supérieur (MIRES), 5.2, 5.2
- Mobilité
-
des chercheurs CNRS, 2.6
- des chercheurs INRIA, 3.6
- Mutation, 1.9.2
- NUMDAM, 7.4.3
- Office national d'études
et de recherches aérospatiales (Onera), 5.2
- Opération
postes (OP), 16.7
- Opération postes
(OP)
-
Machine d'aide au recrutement dans le supérieur (MARS), 16.7
- Opération postes (OP)
-
Academic Mobility Index (AMI), 16.7
- Machine ouverte aux universitaires
qui veulent échanger (MOUVE), 16.7
- Partenariat Hubert-Curien (PHC), 14.3.1
- Personnels ingénieurs, administratifs, techniciens et
ouvriers de service (IATOS), 6.2.1, 6.4.1
- PLM (Plate-forme en Ligne Mathrice), 7.4.3
- Prime d'encadrement doctoral
et de recherche
(PEDR)
-
critères d'attribution de, 1.8.2
- procédure de recours, 1.8.2
- suspension-suppression, 1.8.5
- Prime d'encadrement doctoral
et de recherche (PEDR), 1.5, 1.8.1, 14.6
- Primes (nouvelles), 1.7.3
- Professeur d'université (PR), 1.1, 1.2, 11.1
-
classe exceptionnelle, 1.7.1
- première classe, 1.7.1
- promotions, 1.7.1
- qualification aux fonctions
de, 11
- seconde classe, 1.7.1
- Programme pluri-formations (PPF), 13.1
- Programmes internationaux de coopération scientifique
(PICS), 14.4.2
- Publiants, 1.5
- Réseau national des bibliothèques de
mathématiques (RNBM), 7.4.3
- Réseau thematique de recherche avancée (RTRA), 9.2
- Rapport Goulard, 9.1
- Rapport Schwartz, 1.7.3
- Société de mathématiques appliquées
et industrielles
(SMAI), 15.2
- Société de statistique de Paris (SSP), 15.3
- Société des personnels enseignants et
chercheurs en informatique de France (SPECIF), 16.7
- Société française de statistique (SFdS), 15.3
- Société Mathématique Européenne (SME), 15.4
- Société mathématique de France (SMF), 7.4.3, 15.1
- Subventions aux conférences
- Travaux dirigés (TD), 1.6
- Travaux pratiques (TP), 1.6
- Unité de formation et de recherche (UFR), 1.9.2, 6, 14.6
- Unité mixte de recherche (UMR), 1.10.2, 12.2.3, 13.1.4
- Unité mixte de services (UMS), 7.4.3, 12.2.3
- Unité mixte internationale (UMI), 7.4.2
- Unité propre de
services (UPS), 7.4.3
- Unité support de l'ANR (USAR), 14.1.2
- Validation des services effectués à l'étranger, 11.2.5
|